
Dans le monde du travail, de l’ingénierie, de la gestion de projet ou même dans la vie quotidienne, un adage revient souvent : « Il vaut mieux bien faire du premier coup ».
Si cette maxime peut sembler évidente, elle n’est malheureusement pas toujours appliquée, et les conséquences de l’approximation ou de la précipitation se paient souvent au prix fort.
À Madagascar, où de nombreux projets publics peinent à tenir leurs promesses pour ne citer que le stade Barea, Le Colisée ou Tanamasoandro, ce principe prend tout son sens.
Faire les choses à moitié, remettre à plus tard les vérifications ou négliger les étapes de contrôle, c’est ouvrir la porte à l’accumulation d’erreurs.
Ces erreurs, aussi petites soient-elles au départ, finissent par coûter cher : retards, surcoûts, démotivation des équipes, perte de confiance des partenaires et du public.
Dans le secteur public malgache, combien de routes à refaire chaque année parce que la precedente couche n’a pas été posée dans les règles de l’art ?
Combien de bâtiments publics manaram-penitra fissurés ou inutilisables, faute d’avoir respecté les normes dès la conception ? Combien de systèmes d’information défaillants, car la phase de recueil des besoins a été bâclée ?
À chaque fois, on tente de réparer, de rafistoler, de « faire avec ». Mais réparer coûte toujours plus cher que de bien faire dès le départ.
Les ressources mobilisées pour corriger, patcher, réorganiser ou relancer une initiative auraient pu être investies dans la qualité initiale. Et ce constat vaut pour tous les domaines : de la construction au numérique, de la gestion administrative à l’éducation.
À Madagascar, comme ailleurs, la pression du temps, le manque de moyens ou tout simplement l’habitude poussent parfois à privilégier le « vite fait » au « bien fait ».
On avance, on lance, on inaugure… puis l’on découvre les failles, les oublis, les défauts. Cette culture de l’urgence et du bricolage finit par s’installer, créant un cercle vicieux où chacun s’attend à devoir réparer, où la qualité n’est plus la norme mais l’exception.
Pourtant, les études internationales sont formelles : investir dans la qualité initiale, c’est réduire les coûts à moyen et long terme. Un projet bien conçu, bien planifié, bien exécuté et bien contrôlé dès le départ nécessite moins de maintenance, moins de gestion de crise, moins de ressources pour corriger les écarts.
Si Madagascar souhaite se sortir de ce cercle vicieux il est temps de changer de paradigme. Cela commence par la formation, la responsabilisation, la valorisation des bonnes pratiques et le refus de la complaisance.
Cela passe aussi par l’exigence : exiger de soi, de ses équipes, de ses partenaires, que le travail soit fait correctement, même si cela demande plus de temps ou d’investissement initial.
Bien faire du premier coup, ce n’est pas viser la perfection, mais viser la robustesse, la durabilité, l’efficacité. C’est accepter que la qualité a un coût, mais que ce coût est largement inférieur à celui de la réparation perpétuelle.
À Madagascar, où chaque ariary compte et où les besoins sont aussi vastes que les idées, chaque erreur se paie au prix fort… souvent deux fois plus cher !
Bien faire du premier coup, ce n’est pas un caprice de perfectionniste, c’est une question de bon sens économique. Imaginez un instant : réparer un chantier, c’est comme retaper une vieille voiture avec des rustines en chewing-gum — ça tient un temps, mais ça finit toujours par lâcher au pire moment.
Alors, plutôt que de jouer les apprentis bricoleurs du développement, pourquoi ne pas investir un peu plus d’efforts et de rigueur au départ ? C’est le meilleur moyen d’éviter de transformer les projets en éternels « travaux en cours » et d’économiser des ressources précieuses.






 5119.73 ar
5119.73 ar 4374.44 ar
4374.44 ar





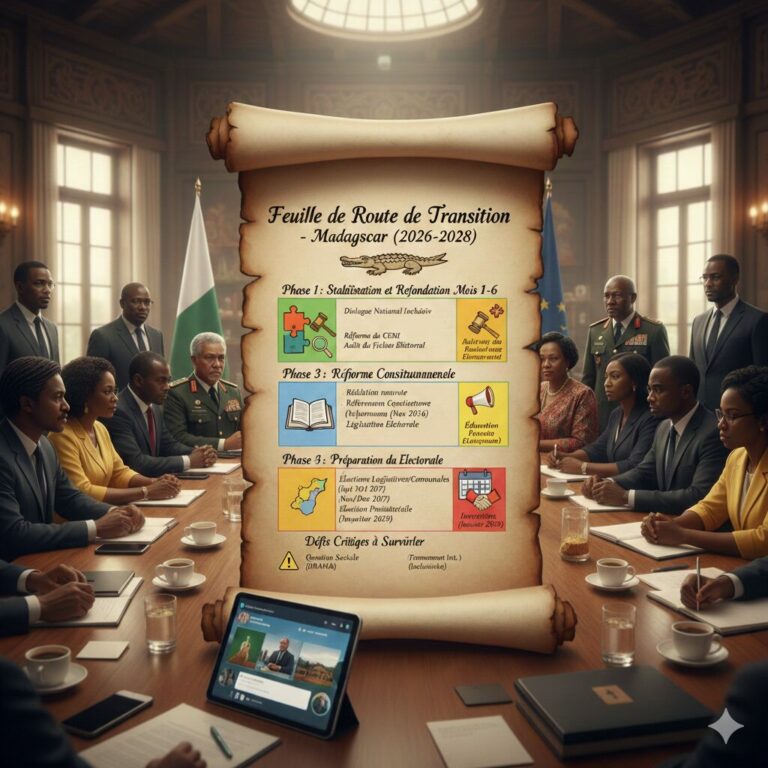


ram’s koa tss..
Autre point de vue (de l’ouvrier) : devoir réparer, rafistoler voire refaire… bah c’est être payé une deuxième fois lol
Effectivement, chacun voit midi à sa porte. Et pour l’ouvrier chaque peine mérite salaire sauf que lui c’est l’exécutant c’est au chef de se préoccuper que tout est fait dans les règles de l’art dès la première fois.
oui mais le chef peut être rarement sur le chantier 24/7 et il suffit que ça ait le dos tourné et patatras ça fait n’importe quoi lol…
C’est pour ça qu’il y a une organisation hiérarchique établi entre le donneur d’ordre et l’ouvrier. le chef de chantier, le chef d’équipe, le contre maître et j’en passe. Mais bizarrement à Madagascar on ne voit que le Nouzallon tout le temps à croire qu’il est et premier ministre, ministre, ingénieur , chef de chantier, distributeur de nouriture…
Il est même chauffeur de taxi à Nosy be pour ramener les belles de nuit.
Bonjour à tous,
Je me décide enfin à commenter sur Actutana que je lis avec attention depuis de nombreuses années.
Lors de mes études universitaires, j’appris que l’organisation se basait sur le POOC=
-Prévoir (=planning)
-Organiser (= dans le but d’effectuer les tâches du planning, comme engager du personnel, faire un plan d’architecte…)
-Ordonner (= “Toi tu fais ceci”,…)
-Contrôler (= le réalisé correspond-il aux objectifs?)
Lors de ma vie, j’appris que le point le moins respecté dans le POOC était le Contrôle.
Ex:
Non respect du tiroir caisse = faillite du commerce, prêts immobiliers ou Lombard type = faillites des banques engendrant la guerre….
Veloma,
JPTFOU
On est tellement souvent titillé par l’envie de répondre 🙂
Ça c’est ce que l’endemique déteste plus que tout lol… Surtout quand c’est un autre endémique qui le fait.
Dans la civilisation oui. A Madagougou tout le monde en a rien à foutre lol. Quand à l’ouvrier, combien sont vraiment spécialisés comme on dit ? 1/10 ? 1/100 ? Je ne dis pas ça gratuitement et méchamment, je les ai quasiment tous fait à Madagougou, je sais de quoi je parle.
Parmi mes connaissances expatriées à Mada (je parle d’entrepreneurs) beaucoup ont été extrêmement déçues et ont quitté l’île.
En vérité,tout succès et ses méthodes devrait être publié, face au racisme d’ex-colons.
Je pense que la civilisation occidentale s’effondre et que l’Afrique sera l’avenir. Alors préparez vous les amis !
La question qui fait toujours débat est « Madagascar fait elle parti de l’Afrique ou pas 🙂
Hein, les Malgaches sont africains ? lol